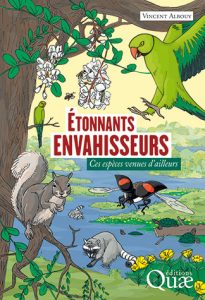Comment contrôler la prolifération d’une espèce invasive ? Plusieurs fois dans l’Histoire, les Hommes ont répondu à cette question en introduisant une espèce exotique, censée être capable de décimer l’envahisseur. Comme en témoigne ces deux exemples, certaines tentatives se sont soldées par un échec tandis que d’autres ont été synonymes de succès.
Comment se débarrasser des rats à la Jamaïque ?
Vous connaissez certainement la Jamaïque pour ses sprinters les plus rapides au monde et pour le reggae. Cette île des Antilles est connue des naturalistes pour l’enchaînement d’introductions censées régler un problème récurrent et provoquant des catastrophes en cascade. Le problème ? Quatre espèces de rats apportées du continent sud-américain par les Arawaks, puis d’Europe et d’Afrique par les Espagnols et les Anglais, colons successifs de l’île.
Les rats prospèrent au milieu des plantations de canne à sucre, causant des ravages importants. En 1762, Thomas Raffles, un administrateur colonial anglais, observe qu’à Cuba les nichées de jeunes rats sont dévorées par la fourmi de feu tropicale. Une fourmilière est importée de Cuba et l’espèce se répand rapidement. Son impact sur les rats est minime, mais elle devient un fléau pour la biodiversité locale.
Les Anglais se rappellent alors qu’en Europe le furet est un excellent chasseur de lapins. À défaut de sa proie, absente de la Jamaïque, il se rabattra sur les rats, pensent-ils. Quelques furets sont lâchés, mais sans succès : des serpents locaux les trouvent à leur goût et les exterminent.
Les planteurs visitant les cultures de canne à sucre d’Amérique du Sud découvrent que le problème des rats ne s’y pose pas. Et les seuls animaux carnivores qu’on y trouve sont des crapauds buffles de 20 centimètres de long. Un certain Anthony Davis les introduit à la Jamaïque en 1844. Leur peau empoisonnée les protégeant des prédateurs, ils s’implantent avec succès, mais délaissent les jeunes rats et dévorent surtout des insectes.
En 1870, 20 % des récoltes sont toujours détruites par les rats. Le planteur W. Bancroft Espeut relâche alors dans sa propriété neuf mangoustes de Java importées de Calcutta. Une dizaine d’années après, les mangoustes se sont multipliées, le rat africain et le rat américain sont exterminés. Mais le rat noir se réfugie dans les arbres à grande hauteur, où il décime les populations d’oiseaux. Le surmulot, quant à lui, devient nocturne pour échapper à la mangouste diurne.
Résultat des courses : des succès minimes à mettre en balance avec des dégâts considérables. De nombreuses espèces indigènes, serpents, lézards, petits mammifères voient leurs populations s’effondrer.
Une cochenille à l’origine de la lutte biologique
Si l’hypothèse de l’absence d’ennemis n’a été explicitement formulée qu’en 2002, les hommes en font usage intuitivement depuis la plus haute Antiquité, comme les Égyptiens de l’époque pharaonique qui introduisaient des chats dans leurs greniers pour contrôler rats et souris. L’entomologiste américain Charles Riley, quand il conduisit la première expérience scientifique de lutte biologique, en Californie, à la fin du XIXe siècle, s’est aussi appuyé implicitement sur cette hypothèse. Reprenons l’histoire à son début. En 1868, une cochenille, petit insecte suceur de sève proche des pucerons, arrive en Californie sur des plants d’acacia importés d’Australie. Elle se met à proliférer sur de nombreuses plantes. En quelques années, les vergers d’orangers et autres agrumes sont ravagés, conduisant de nombreux arboriculteurs à la ruine.
En 1883, les autorités confient à Riley, directeur du Bureau fédéral d’entomologie, l’organisation de la lutte. Celui-ci émet alors une hypothèse, la cochenille faisant des ravages en Californie, mais passant inaperçue en Australie, où les mêmes agrumes sont cultivés : des ennemis naturels doivent limiter ses populations dans son aire d’origine. Vous reconnaissez là, exprimée sous une forme un peu différente, l’hypothèse de l’absence d’ennemis. Riley parie qu’en introduisant ces ennemis en Californie, la cochenille australienne pourrait être contrôlée.
Les bureaucraties excellant dans l’art de ralentir les prises de décision, c’est seulement en 1888 qu’une mission scientifique part collecter en Australie une série de prédateurs et de parasites de la cochenille australienne. Parmi ceux-ci se trouve une coccinelle de quelques millimètres de long. Mises en élevage, les 125 coccinelles arrivées vivantes en Californie donnent une dizaine de milliers de descendants, relâchés dans des orangeraies infestées.
En quelques mois, les populations de la cochenille s’effondrèrent au point de ne plus causer de pertes économiques sensibles. Le résultat fut durable, la coccinelle australienne se multipliant d’elle même dans la nature. La culture des agrumes était sauvée. Une belle preuve de la justesse de l’hypothèse : pas d’ennemis, prolifération ; un seul ennemi, et la cochenille se naturalise sans plus proliférer. Cela ne s’est vérifié que jusqu’à l’arrivée des insecticides chimiques de synthèse après la Seconde Guerre mondiale : en détruisant aussi la coccinelle australienne, ils ont déclenché la résurgence des pullulations de cochenille australienne.
Source : Étonnants envahisseurs de Vincent Albouy, paru aux éditions Quæ